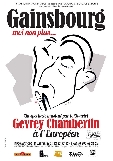Mise en scène de Fernand PRINCE
Mise en scène de Fernand PRINCE
Avec Fernand PRINCE, Basile SIEKOUA, Victor LEGRAND
Peut-on faire parler un esclave ? Oh combien nous souhaiterions voir ce mot rayé du vocabulaire ! Songeons nous vers quels écueils de pensées, d’effrois, d’incompréhension, le mot esclave nous entraîne ? Cela résonne comme une sorte d’écharde au fond de la conscience. Quand des hommes, des femmes, des enfants pouvaient être considérés comme des marchandises par d’autres, parce qu’ils étaient sans défense. Oui, voilà que le mot marchandise nous heurte à nouveau l’esprit. Parce que nous n’y pouvons rien, parce qu’en tant qu’individus, nous pensons n’être que de passage, nous pourrions oublier la question en soulignant qu’il s’agit de la loi du plus fort et que la nature humaine porte en son sein le mal, quoiqu’on dise.
Certains hommes pourtant ont déclaré qu’il fallait l’arracher cette écharde, qu’il fallait la regarder en face parce qu’ils ont besoin de penser la vie comme des hommes libres. Ils songent qu’il leur appartient de dire ce qu’ils veulent être et cela a un prix, celui de se retourner sur des douleurs, des humiliations. Se comprendre en tant qu’être humain, dans le monde, c’est toujours d’actualité. Si nous nous en référons pas à notre mémoire, à notre conscience, à notre perception, à quoi nous servent-elles, autant être morts.
Le texte de Jacques Bruyas, écrivain voyageur, adapté par Fernand Prince, est inspiré notamment du livre de Serge Bile, Alain Roman et Daniel Sainte-Rose « Paroles d’esclavage, les derniers témoignages » publié par Pascal Galodé. En visitant une vieille bâtisse d’esclaves, à Agbodrafo au Togo, Jacques Bryas a ressenti le besoin de donner la parole à un esclave Jacob qui dit ceci :
« Chaque africain sait qu’il y a 3 pays, le pays de la clarté où vivent tous les êtres visibles, hommes, animaux, plantes, le pays de la pénombre où se trouvent « les cachés » les êtres invisibles mais sujets à incarnation, enfin le pays de la nuit profonde où se trouvent les morts. »
Cette perception de la mort, du monde invisible est sous-jacente aux propos de Jacob, esclave devenu comptable du nombre des victimes de l’entreprise d’esclavage WOOD HOME. Il a recours à des contes et proverbes sages africains pour chercher une réponse à l’horreur. Et c’est lui-même qu’il fustige un peu comme un anti- héros shakespearien « Comment ai-je pu échapper à cette invitation de la mort ? Je suis esclave et je le reste, embusqué sous le taillis de la peur et de ma lâcheté ».
A travers ce monologue, l’on entend le visage de tout homme, on traverse des continents. La parole de Jacob peut franchir des fleuves, des montagnes et multiples frontières, il s’agit d’un paysage humain à notre portée puisqu’’il s’agit de la tête et du corps dont nous avons hérité.
Fernand PRINCE devient l’incarnation non pas d’un esclave mais d’un homme désigné de façon ignomineuse comme un esclave qui ne cesse de s’interroger : « Et dire que des hommes ont pu imaginer ceci » : l’esclavage justifié par le commerce triangulaire et régenté par le code noir à la fin du 17ème siècle. Fernand PRINCE, Basile SIEKOUA , Victor LEGRAND mêlangent leurs voix avec force et retenue pour exprimer les états d’âme de Jacob, heureux de témoigner aussi en leur âme et conscience d’artistes.
Ils incarnent avec bonheur la parole de Jacob qui en racontant son histoire puise aussi dans la poésie et la danse, le moyen d’exprimer ses sentiments lesquels grâce au son discret du djembé assuré par Victor Legrand, rejoignent l’invisible, le monde sans partage des vivants et des morts.
Cela dit, il s’agit d’un spectacle très vivant, et très visible, où tout se tient, interprétation, texte, mise en scène simple et éloquente, tam-tam mélodieux du djembé, avec un message important , celui de Jacob que vous ne ferez pas mentir « Ce n’est pas en vain que je m’appelle Jacob, esclave d’Agbodrafo Word Home « . Courez à ce spectacle, il est temps de le découvrir avant qu’il prenne les voiles pour Avignon !
Paris, le 24 Février 2013 Evelyne Trân