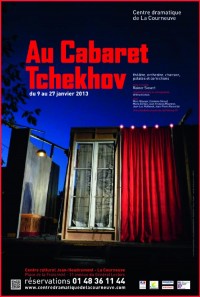N. B : Yves CUSSET était l’invité de l’émission « DEUX SOUS DE SCENE » sur Radio Libertaire 89.4, le samedi 2 Février 2013. ( l’émission en podcast peut être écoutée et enregistrée en allant sur la grille de Radio Libertaire ) .
 Le titre de la pièce d’Yves CUSSET, il me semble, résonne comme une goutte de pluie sur le bout du nez. Il est jeune, très jeune. On s’attendrait à voir débarquer sur scène Archimède et sa pomme car nous sommes tout de même impressionnés par le bagage philosophal d’Yves CUSSET.
Le titre de la pièce d’Yves CUSSET, il me semble, résonne comme une goutte de pluie sur le bout du nez. Il est jeune, très jeune. On s’attendrait à voir débarquer sur scène Archimède et sa pomme car nous sommes tout de même impressionnés par le bagage philosophal d’Yves CUSSET.
Comment s’étonner qu’il ait quitté ses guêtres de professeur. Il n’était pas né. Quand à faire du yoyo, en brassant quelques airs d’Heidegger, de Sartre ou de Descartes, sous l’œil ahuri de quelques adolescents désenchantés, pourquoi pas ? Mais n’être pas né, ça vous donne un choix incroyable, celui de pouvoir superviser en toute liberté, tous ces futurs qui nous entourent et qui résistent justement parce qu’ils ne sont pas encore nés.
Mieux vaut décliner sur le mode de l’enfance, nos tentatives de charabia philosophique. Ça ne mange pas de pain de s’estimer suffisamment môme dans l’âme pour prodiguer à sa façon quelques aphorismes mués en rôts ou gazouillements divers.
Nos états d’âme en grenouillère ont cela d’inouï qu’encore très proches du cordon ombilical, ils débordent de sensualité, de tendresse, enfin tout ce qu’il faut pour rester insensibles au manège des savants pour qui n’être pas né ne veut rien dire.
Dans le fond Yves CUSSET joue l’enfant qui ramasse les mots tels qu’il les entend, tels qu’il les attrape avant de leur faire subir le hic et le hoc du flou de la question, en grand téméraire un peu filou qui guette les spectateurs, prêts à mordre à l’hameçon.
C’est qu’à tout moment le spectateur qui s’amuse de voir un homme pas né, ouvrir le chantier de sa prochaine naissance au milieu de poupées bien malmenées, de confettis, de confidences qui ont tout l’air de sortir d’un oreiller en plumes ou du ventre de belle maman, oui eh bien, le spectateur est tenté de les repêcher ces belles plumes pour chatouiller le beau prêcheur et pour vérifier, comme il se doit, leur pesant d’or.
Il lui pend des paroles qui n’étoufferont certes pas notre raison, mais à n’en pas douter, cet homme pas né a bien du talent. Il nous fait un peu penser à nous, lorsqu’en nous réveillant, n’étant pas encore nés, nous nous posons la question « Où suis-je ? »
Professeur Yves CUSSET, soyez donc la plume de notre naissance, vos sourires questions valent bien un réveil. Bravo !
Paris, le 27 Janvier 2013 Evelyne Trân