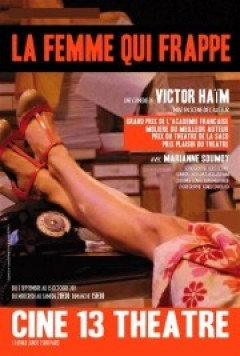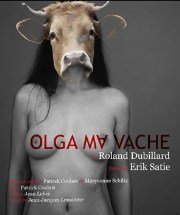Spectacle pour un container, 2 acteurs, 1 vidéo projecteur et 100 poupées
Spectacle pour un container, 2 acteurs, 1 vidéo projecteur et 100 poupées
Au festival Mondial des Théâtres des Marionnettes de Charleville-Mézières du 16 au 25 Septembre 2011
Paumé au milieu de la superbe Place Ducale de Charleville-Mézières, le container, couleur bleue cire, a piètre mine et il faut l’avouer n’attire pas les curieux qui courent dans tous les sens pour assister aux petits spectacles de marionnettes de rue qui enchantent leur ville, tous les deux ans grâce à leur festival.
Et pourtant cet objet ingrat a trouvé sa place au sein du festival parce qu’il parle. Il est auréolé d’une belle phrase peinte en blanc : Est-ce que le monde sait qu’il me parle. L’on ignore qui en est l’auteur. Toutes seules, les lettres qui dansent au soleil pourraient faire figure de marionnettes pour faire se venger Rimbaud de ses propres lettres qui stagnent encore quelque part dans les ruelles de nos enfances.
C’est avec une petite appréhension que les spectateurs s’engouffrent dans cette poubelle en tôle, ils ont peut être à l’esprit que ce genre d’objet peut être hissé sur un bateau, qu’il représente à sa manière une malle qu’ils vont habiter, l’espace de 40 minutes, pour écouter la plaidoirie d’un ailleurs ou des ailleurs en frange si souvent occultés.
« Suis-je donc moi aussi un cobaye ? » se demande le spectateur qui est assailli d’emblée par le dévergondage de deux acteurs en habits de travail, venus réciter tout ce que notre environnement nous sert en termes d’étiquettes, de consignes, publicités, annonces enregistrées, papiers gras, formules de politesses, et j’en passe…
Au fur et à mesure qu’ils écoulent les petites phrases bien peignées qui assurent notre quotidien, et notre mode d’emploi, de grosses poupées à poil mais en tissu tombent de la lucarne et s’affaissent dans un bruit glauque. Cadavres exquis, pas si sûr, ces poupées flasques ne sont que des sacs insignes qui ne comprennent rien, aussi vides de sens qu’un drapeau humain planté sur la lune.
Les deux personnages qui empruntent l’allure d’employés robots sont juste en train de nous dire que nous passons notre temps à nous faire avoir par des mots qui parlent à notre place, à tel point que bientôt, il ne sera plus nécessaire de remuer sept fois notre langue avant de parler, ni de mettre des cailloux dans notre bouche pour apprendre à bien articuler, nous n’aurons plus besoin que de réciter d‘une voix blême ce qu’on nous aura appris, assené cent fois par jour, à la télé, au cinéma, sur les pancartes publicitaires.
Ce qui nous guette au final c’est de devenir les domestiques de robots étincelants et bientôt la différence sera nulle, nous ne saurons plus qui du robot qui de l’humain parle. Au secours, a-t-on jamais vu un robot se suicider ? Si, dans « 2001, l’odyssée de l’espace » de Kubrick, espoir un peu hard mais tout de même.
Une allusion qui fonctionne quand soudain la porte du container – vaisseau spatial – s’ouvre, c’est vers l’infini que semble se diriger l’employée domestique …
Face à cette vision désincarnée du monde, pince-sans-rire, les acteurs deviennent presque fluides, ce sont leurs larmes étoiles qui rayonnent. Oh, juste une image, juste un confetti bleu, tombé du ciel, un détail pour nous emporter, dire que nous sommes libres de créer notre monde.
Après cette petite saignée de mots, nous savons bien que nous replongerons dans le monde des étiquettes mais il y a encore tellement de choses à faire, n’est ce pas, pour se réveiller de notre torpeur. C’est le paradoxe d’une telle mise en scène où les spectateurs sont partie prenante d’un discours qui leur appartient de ranimer.
Voilà un spectacle de qualité, substantiel et généreux, servi par de remarquables comédiens !
Paris, le 28 Septembre 2011
Evelyne Trân